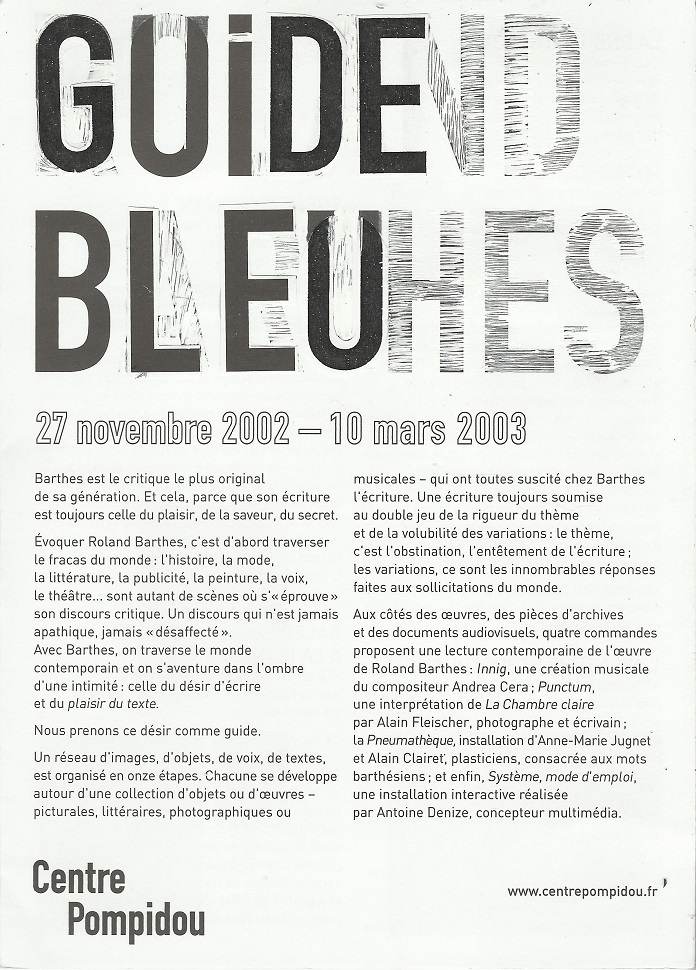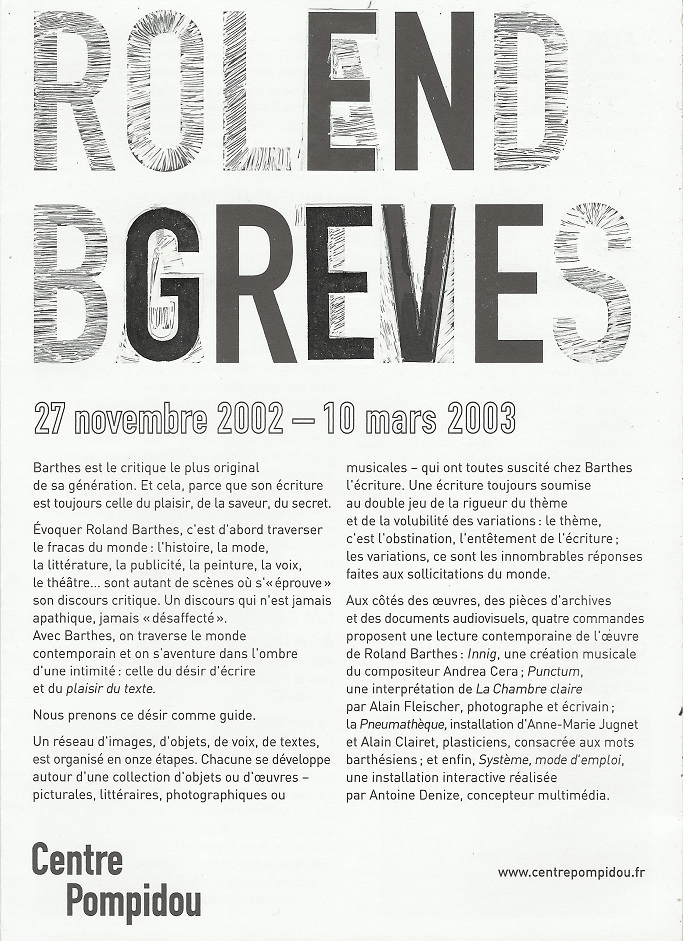Guide Bleu (2002-2003)
Quelle critique aurait pu écrire Roland Barthes lui-même à propos de l’exposition Roland Barthes au Centre Georges Pompidou, du 27 novembre 2002 au 10 mars 2003 ? Quelles réflexions aurait suscité la fiction de cet étalage d’une reconstitution des scènes du fracas du monde où s’éprouve son discours critique ainsi que la lecture contemporaine de l’œuvre de Roland Barthes? Rendait-elle publique, implicitement, la fonction que Barthes accorde au mythe : « une parole dépolitisée » ou la quantification de la qualité – en réduisant toute qualité à une quantité, « le mythe fait une économie d'intelligence : il comprend le réel à meilleur marché »? Rendait-elle publique la tautologie comme « évanouissement à point venu, aphasie salutaire, une mort, ou une comédie, la « représentation » indignée des droits du réel contre le langage. Magique, elle ne peut, bien entendu, que s'abriter derrière un argument d'autorité (…) la tautologie fonde un monde mort, un monde immobile » ? Ou encore, se travaillait-il publiquement le Spectrum, où se joue le spectacle de l’Opérator, du spectator et de l’eidôlon, et qui, telle une séance spirite, simulait le retour du mort?
Si l’exposition n’était pas pensée pour être exposée à la lumière « des conditions de publicité » des textes critiques de Barthes, les instances de diffusion – de publicité – invitaient pourtant à traverser le monde contemporain et à s’aventurer dans l’ombre d’une intimité : celle du désir d’écrire et du plaisir du texte. Je pris à la lettre cette invitation à plusieurs titres : d’une part, par l’analyse situationnelle de cette exposition, au cours de laquelle l’institutionnalisation de la dissuasion m’est apparue particulièrement lisible – s’y jouait-il le tour de force opéré par l’infra-idéologie : Pierre Macherey dans son ouvrage, Le sujet des normes, nous indique qu’ « elle tend à déguiser en nécessité de fait, de part en part naturelle, une régulation des comportements qui est en réalité associée à une conception historique du monde que le sujet des normes est appelé à endosser avant même de savoir à quoi il s’engage en lui servant de lieu d’accueil. »
Elucider la participation dite « active » du public dévoilerait-il ce que Baudrillard qualifie d’efficacité dissuasive ? Une étude ambigüe, en ce qu’elle chercherait le sens de la dissuasion culturelle – tout en contribuant à en « faire la publicité » – alors que cette opération « révolutionnaire », toujours selon Baudrillard, est « involontaire », « insensée » et « incontrôlée ». Par conséquent, toute acte critique ne serait-il non pas impossible mais déjà instituée?
L’attention portée aux dispositifs de publicité ne visait pas le refus d’une politique culturelle ou l’appel d’une politique culturelle définie à partir de la nostalgie d’un sens commun fixe, figé et normatif. Changer l’orientation de l’éclairage pour mettre en lumière les stratégies de publicité nous permet de repérer si elles s’ouvrent à « une multitude de formes dissensuelles ». Pratiques qui favoriseraient l’autorisation du dérangement, du déplacement de toute entreprise de glaciation de l’expérience esthétique, où du dit se délie l’inter-dit, où du visible se délivre l’invu, où de l’entendu se libère l’inouï, où du su se dénoue l’insu, où du toucher se détache l’intact. Une autorisation qui ne se limite pas aux aspects fonctionnels de la pratique culturelle mais inclut l’expérience : non pas tant l’expérience prévue et préméditée par l’institué, que celle déployant « les dimensions multiples du vécu, avec ses composantes individuelles et collectives, psychologiques et socio-politiques, ses processus manifestes et inconscients », qui relèverait du travail de l’instituant.
Un dispositif reste toujours réversible si le regard se porte sur les processus d’indexation permettant de délier l’objet de ses modes opératoires de publicité. Il relève alors d’une approche situationnelle qui révèle la tension nécessaire entre l’instrumentalisme et le dramatique (Gilles Ferry) pour participer avec lucidité à ce drame culturel. Nous ouvrons la conception de Gilles Ferry en articulant les situations éducatives aux situations culturelles pour préciser l’approche situationnelle dans ce contexte : toute approche qui développe une problématique de la formation fondée sur la relation du sujet aux situations éducatives, et (nous ajoutons) de publicité, dans lesquelles les publics sont engagés, y compris la situation de leur propre formation à devenir public. « La relation à une situation implique tout à la fois une position dans sa structure spatio-temporelle et son champ institutionnel, et une part prise au jeu des interactions qui s’y déroule (…), avec ses péripéties, ses ambiguïtés, ses retentissements sur les acteurs. »
En rendant publics tout autant le fonctionnement des instances de publicité et les normes qui les sous-tendent, l’approche situationnelle redonnerait-elle à l’espace public son véritable sens ? C’est le sujet-visiteur et la manière dont il s’éprouve dans les pratiques de publicité instituées qui est au centre de cette approche. Est-elle animée par le désir d’« ouvrir les voies pour une multitude de formes dissensuelles et de pratiquer le brouillage de la frontière entre ceux qui agissent et ceux qui regardent, entre individus et membres d’un corps collectif »? Une pratique qui ne s’exercerait pas seulement dans le cadre d’une institution artistique et culturelle mais à tous les moments de la vie sociale.
Ce que l’exposition, en question, met en œuvre, c’est, nous informe-t-elle, la mise en scène du désir d’écrire et du plaisir du texte. Après ma première visite, j’ai récupéré quelques dizaines de dépliants et décidé de sur-titrer le titre officiel ; une moindre intervention sur le support de la médiation entre l'institution culturelle et le public : une opération d’effacement puis d’écriture – puisque l'exposition était censée susciter ce désir. Voici quelques titres surexposés à celui officiellement nommé « ROLAND BARTHES »:
OBTUS
SPECTRUM
GUIDE BLEU
ROLAND CATCHE!
STRIP-TEASE
EN GRÈVE
ASTRA
Des dizaines de dépliants rebaptisés ont été ainsi remis en circulation dans les bornes du Centre Georges Pompidou jusqu’à la fin de l’exposition.
La vocation de cette action relevait-elle de la recherche d’une forme dissensuelle évoquée précédemment ? Un dépliant rebaptisé devient-il un « tract » qui aurait la prétention de – soyons fous ! - démythifier pour politiser ? Aucune attitude du public ne fût réellement décelable si ce n’est celle, amusante, de quelques visiteurs qui s’étant aperçus qu'ils avaient pris un dépliant « retouché », le replacèrent sous la pile de ceux qui étaient « intacts » pour en prendre un autre plus « propre ! ». D’ailleurs, qu’aurais-je pu provoquer concrètement ?
-
Une nouvelle lecture des pratiques de publicité à l’aune des textes critiques de R.B. ?
-
Un désir (naïf ?) d’écrire au-delà des marges autorisées ?
-
Une récupération institutionnelle –ne suis-je pas en train de l’effectuer par ce texte ?
-
Une démonstration de « l'opération Astra » analysée par R. B. qui insinue « dans l'Ordre le spectacle complaisant de ses servitudes » comme « moyen paradoxal mais péremptoire de le gonfler » ?
C’est résolument l’analyse non pas de la rentabilité de l’action dont il est question ici mais de ses conditions de publicité et de son efficacité. L’efficacité de cette action n’est-elle pas justement de reconnaître qu’elle ne fait rien bouger ? Elle ne peut revêtir une forme dissensuelle, au sens donné par Jacques Rancière, dans le contexte de cette exposition puisqu’elle reste invue et inédite, ne remettant pas en fiction les politiques de l’art explicitement.
Qu’en est-il du geste furtif ou de l’action parasite, "peu" ou disruptive dans les pratiques artistiques ? Si ces actions instaurent une dimension paradoxale de l’art, c’est, probablement, dans leur passage à la publicité, lorsqu’ « en officialisant ce qui s’est constitué dans la marginalité », l’institution « légitime » une expérimentation visant à la singularité d’une expression qui ne peut être authentique que si elle est autonome, détachée du jugement d’autrui » et située hors de l’espace public culturel. Mais n’est-ce pas dans la quête implicite et ambigüe de la notoriété que ce geste acquiert une dimension paradoxale ? Si nous prolongeons l’analyse situationnelle, cette fois, sur l’opération d’indexation du geste disruptif, nous retraçons toujours une histoire de sa spectacularisation : ce geste disruptif de l’artiste en apparence anonymisé, effectué à l’origine dans l’espace public puis transposé dans un espace public culturel, cesse d’être « parasite », « peu », « furtif », puisqu’il accède au temps de sa consécration. C’est sa traversée et sa médiatisation par les différentes instances de publicité, à l’épreuve de la relation institué / instituant, qui donne au « geste » son premier sens : celui de prendre sur soi et de supporter ses paradoxes, démontrant que déranger et ranger se confondent. Serait-ce alors la reconnaissance des contradictions de l’action, dite critique par la pratique artistique, ou de l’'infiltration dite par l’intérieur, qu’il s’agirait de rendre publique, comme condition nécessaire d’une position politique et critique de l’artiste ? Rendre public ne vise pas à œuvrer pour la reconnaissance de l’artisticité du geste politique et critique, de sa complaisance à la conformité, mais d’analyser ses publicités pour saisir les systèmes de relations qu’il implique avec le plus de lucidité possible. En en retraçant le principe générateur, tout en se situant dans le mouvement même de son effectuation et de sa traversée dans les dispositifs structurés dans lesquels il s’actualise, il est alors l’analyseur des conditions de l’action politique et critique.
Exposition Roland Barthes 2002, Centre Georges Pompidou, MNAM, dépliants, colle, stylo bille, typex